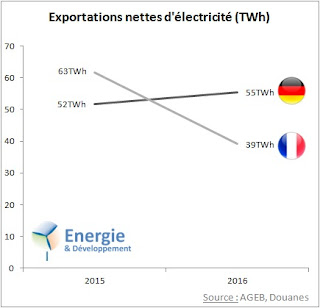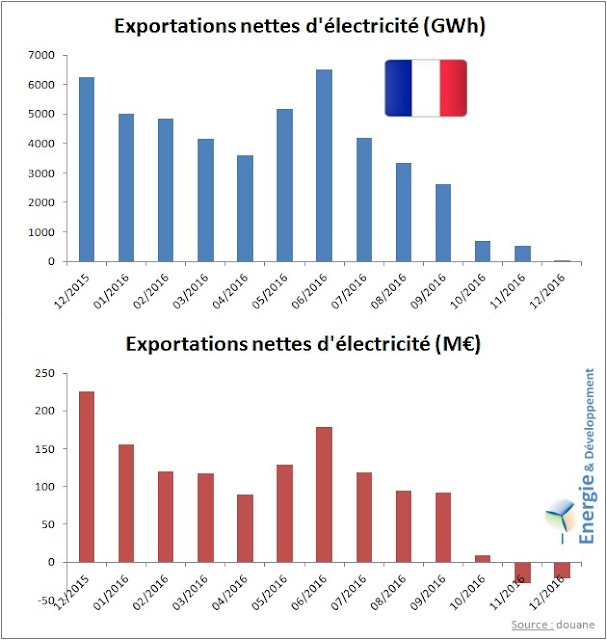Si vous cherchez un événement historique qui symbolise à la fois l'obscurantisme le plus profond, la cruauté la plus féroce et les sentiments humains les plus vils, il y a des chances que la chasse aux sorcières vous vienne à l'esprit.
Se pourrait-il que les cette face obscure de la Renaissance européenne ait été, pour tout ou partie, causée l'évolution du climat ? Nous allons voir que l'hypothèse n'est pas aussi loufoque qu'elle peut sembler au premier abord.
Et si c'est le cas, cela ne devrait-il pas nous faire redouter encore plus le changement climatique dans lequel, à notre tour, nous nous engageons ?
Cet article fait partie d'une série d'été consacrée au rôle du climat
dans l'histoire. Retrouvez un nouvel article mercredi prochain et, en
attendant, les articles déjà parus :
Commençons par le commencement : la chronologie.
La chasse aux sorcières prend naissance dans les Alpes au milieu du XVe siècle. Elle est lancé "officiellement" par une bulle papale de 1484. Un temps contenue par les critiques des humanistes, elle embrase l'Europe dans la seconde moitié du XVIe siècle et culmine au tournant du XVIe et du XVIIe siècle. Pendant cette période, au moins 110.000 procès en sorcellerie ont lieu dont 60.000 se terminent par une exécution.
Cette époque correspond à un changement climatique en Europe : après l'optimum climatique médiéval, une période relativement douce qui s'étend grosso-modo de l'an 1000 aux alentours de 1300, le continent se refroidit progressivement. Ce "petit âge de glace" s'amorce au XIVe siècle et culmine au XVIIe.
Entre le point le plus haut de l'optimum climatique médiéval et le point de plus bas du petit âge glaciaire, la température moyenne baisse de l'ordre de 1°C en Europe. C'est peu, beaucoup moins que la variation de 2 à 4°C qui nous attend certainement au cours du XXIe siècle, mais c'est largement suffisant pour bousculer les sociétés qui subissent ce refroidissement.
Evidemment les contemporains ne savent rien de ce petit âge de glace. Ce qu'ils voient ? Des hivers plus longs et plus froids que ceux auxquels ils sont habitués. Des cultures qui déperissent entraînant parfois avec elles des pans importants de l'économie : c'est l'époque où la vigne et le vin, par exemple, disparaissent du centre et du nord de l'Europe. Et des phénomènes climatiques - tempêtes, grêle, gelées et neiges tardives... - qui leur apparaissent sans précédent...
Face à ces phénomènes qui les dépassent, ils vont naturellement chercher des explications. Or à depuis la fin du Moyen Âge, la doctrine chrétienne admet les interférences humaines dans le climat.
Selon les termes de Saint Thomas d'Aquin : "le monde des corps obéit naturellement à celui des esprits pour ce qui est mouvement local. Par conséquent le diable a le pouvoir de causer dans ce monde inférieur tout ce qui peut provenir du mouvement local". Or la météo est bien un de ces mouvements locaux puisque "le vent, la pluie et d'autres dérangements similaires peuvent être causés par le seul mouvement de la vapeur libérées par la terre ou par l'eau", rien n'empêche dès lors que le démon et ses alliés s'en mêlent.
S'appuyant sur ce passage de St Thomas, le fameux Malleus Maleficarum, manuel de référence en matière de sorcellerie publié à Strasbourg à la fin du XVe siècle, est parfaitement explicite : "le diable et ses disciples peuvent par sorcellerie créer des éclairs, des orages de grêle, des tempêtes".
La manipulation de la météo se retrouve donc dans d'innombrables procès en sorcellerie. La sorcière faiseuse de grêle en particulier est un classique de la démonologie : en Lorraine, dans les années 1590, sur près d'un milliers de procès, 22% mentionnent (entre autres) l'invocation de la grêle. Au XVIe siècle, elle figure dans un acte d'accusation sur 5 à Zurich...
La cas de l'été 1562 en Allemagne illustre le lien entre caprices de la météo et vagues de persécutions. En aout 1562, l'Europe centrale est traversée par une violente tempête. Après quelques années froides et humides, qui ont amené leurs lots de récoltes endommagées, d'innondations et d'épidémies, la sensibilité de la population à ce type d'événements est déjà exacerbée : la foule gronde et réclame des responsables.
Dans la petite ville de Wiesensteig, entre Stuttgart et Ulm, le seigneur local accepte d'emprisonner quelques femmes. Mais loin de faire cesser les persécutions, ces concessions les attisent : les arrestations sont suivies de torture et, inévitablement, d'aveux et de dénonciations... qui mènent à de nouvelles arrestations, etc. Une mécanique implacable se met en route et bientôt les bûchers fonctionnent à plein régime. Avant la fin de l'année 1562, 63 femmes sont brûlées à Wiesensteig.
Ce massacre, qui a inspiré rapidement plusieurs livres qui seront traduits et réédités, est parfois cité comme le vrai début de la chasse aux sorcières en Europe.
La cas n'est pas isolé : on retrouve le même scénario en Allemagne encore en 1570 (famine causée par deux années froides), en Europe centrale à la fin des années 1570 (famine aussi), en Franconie en 1626 (gelée tardive : à Bamberg 600 personnes sont brûlées vives, 900 à Wurzburg...), etc.
Ces chasses aux sorcières semblent souvent avoir été initiées par un mouvement populaire. Dans certains cas, la foule va jusqu'à élire des délégués qui mènent l'enquête, arrêtent et torturent pour ne remettre les "coupables" aux autorités qu'une fois les aveux obtenus. Au milieu de cette hystérie collective, que font les élites ?.
Il est intéressant d'observer le rôle de la noblesse et du clergé face à ces désordres. Beaucoup vont laisser-faire et attendre parfois très longtemps l'occasion de reprendre en main la situation : dans la principauté archiépiscopale de Trèves, il faut une décennie (de 1581 à 1591) et 350 bûchers pour que la populace se calme... Quelques uns vont prendre eux-même la tête de la chasse.
Mais d'autres, plus courageux ou plus éclairés, vont tout de même se soulever contre ces pratiques barbares : c'est le cas par exemple de l'archevèque de Reims en 1644, lorsque la foule réclame des responsables pour les gelées tardives qui ont détruit le raisin.
Ce sont finalement ces élites politiques qui auront raison de la chasse aux sorcières. A la fin du XVIe siècle des États forts se construisent en Europe occidentale : la France, l'Espagne, l'Angleterre ne tolèrent plus les élans populaires et décriminalisent la sorcellerie. Les législateurs, sur ce sujet, ont devancé les philosophes...
Mais dans l'Europe centrale et orientale qui reste morcelée et aux mains de dirigeants instables, les persécutions se poursuivent tard dans le XVIIIe siècle.
Il est donc clair que des épisodes météorologiques défavorables ont joué un rôle dans le déclenchement de certaines vagues de persécutions, mais peut-on aller jusqu'à dire que la grande chasse aux sorcières dans son ensemble est causée par la variation du climat que l'Europe connaît à la même période ?
Pour l'historien allemand Wolfgang Behringer, la réponse est oui : selon lui, en provoquant des événements climatiques d'apparence anormale voire surnaturelle, l'entrée dans le petit âge glaciaire a provoqué le retour de la chasse aux sorcières dans la seconde moitié du XVIe siècle et l'a amené à des dimensions inconnues jusqu'à là. D'autres, dont le spécialiste français Emmanuel Le Roy Ladurie, se montrent moins catégoriques.
Retenons simplement ce qui est certain. Les événements météorologiques extrêmes frappent les esprits et détruisent en un instant de longs efforts. Encore plus insidieuses, les évolutions lentes du climat ruinent et tuent sans qu'il soit toujours possible de vraiment discerner les causes de ces calamités. Tout cela appelle des boucs-émissaires. Il en sera probablement de même demain.
Serons-nous capables de mieux nous comporter que nos ancêtres face aux dérèglements du climat ? Evidemment, nous sommes bien mieux informés qu'eux, et déjà à la Renaissance la science était un des antidotes à la barbarie : c'est en partie pour réfuter toute intervention diabolique que la météorologie commence à se développer, sous l'impulsion par exemple de Leonhard Reynmann.
Mais malgré toutes nos connaissances, face aux éléments, n'y-t-il pas un fond d'humanité, ou d'inhumanité, qui reste inchangé - la peur, l'instinct de groupe, le besoin d'explications simples - et qui pourrait l'emporter ?
Les principales sources de cette articles sont :
Publié le 1er aout 2018 par Thibault Laconde
Se pourrait-il que les cette face obscure de la Renaissance européenne ait été, pour tout ou partie, causée l'évolution du climat ? Nous allons voir que l'hypothèse n'est pas aussi loufoque qu'elle peut sembler au premier abord.
Et si c'est le cas, cela ne devrait-il pas nous faire redouter encore plus le changement climatique dans lequel, à notre tour, nous nous engageons ?
 |
| Sorcières invoquant le mauvais temps (illustration de 1489) |
- Introduction de la série
- Vagues de chaleur : hier et aujourd'hui
- La chasse aux sorcières et le petit âge glaciaire
- Hiver volcanique et littérature fantastique
- Le printemps 1907 : y a-t-il de bons changements climatiques ?
- Le climat dans l'ombre des révolutions ?
La chasse aux sorcières est contemporaine d'un refroidissement du climat
Commençons par le commencement : la chronologie.
La chasse aux sorcières prend naissance dans les Alpes au milieu du XVe siècle. Elle est lancé "officiellement" par une bulle papale de 1484. Un temps contenue par les critiques des humanistes, elle embrase l'Europe dans la seconde moitié du XVIe siècle et culmine au tournant du XVIe et du XVIIe siècle. Pendant cette période, au moins 110.000 procès en sorcellerie ont lieu dont 60.000 se terminent par une exécution.
Cette époque correspond à un changement climatique en Europe : après l'optimum climatique médiéval, une période relativement douce qui s'étend grosso-modo de l'an 1000 aux alentours de 1300, le continent se refroidit progressivement. Ce "petit âge de glace" s'amorce au XIVe siècle et culmine au XVIIe.
Entre le point le plus haut de l'optimum climatique médiéval et le point de plus bas du petit âge glaciaire, la température moyenne baisse de l'ordre de 1°C en Europe. C'est peu, beaucoup moins que la variation de 2 à 4°C qui nous attend certainement au cours du XXIe siècle, mais c'est largement suffisant pour bousculer les sociétés qui subissent ce refroidissement.
"La chasse aux sorcières, qui a fait au moins 60.000 victimes en Europe, se déroule au moment où le continent entre dans le petit âge glaciaire. Changement climatique et persécutions sont-ils liés ?"
Evidemment les contemporains ne savent rien de ce petit âge de glace. Ce qu'ils voient ? Des hivers plus longs et plus froids que ceux auxquels ils sont habitués. Des cultures qui déperissent entraînant parfois avec elles des pans importants de l'économie : c'est l'époque où la vigne et le vin, par exemple, disparaissent du centre et du nord de l'Europe. Et des phénomènes climatiques - tempêtes, grêle, gelées et neiges tardives... - qui leur apparaissent sans précédent...
Pour la théologie médiévale, le diable peut intervenir dans le climat
Face à ces phénomènes qui les dépassent, ils vont naturellement chercher des explications. Or à depuis la fin du Moyen Âge, la doctrine chrétienne admet les interférences humaines dans le climat.
Selon les termes de Saint Thomas d'Aquin : "le monde des corps obéit naturellement à celui des esprits pour ce qui est mouvement local. Par conséquent le diable a le pouvoir de causer dans ce monde inférieur tout ce qui peut provenir du mouvement local". Or la météo est bien un de ces mouvements locaux puisque "le vent, la pluie et d'autres dérangements similaires peuvent être causés par le seul mouvement de la vapeur libérées par la terre ou par l'eau", rien n'empêche dès lors que le démon et ses alliés s'en mêlent.
S'appuyant sur ce passage de St Thomas, le fameux Malleus Maleficarum, manuel de référence en matière de sorcellerie publié à Strasbourg à la fin du XVe siècle, est parfaitement explicite : "le diable et ses disciples peuvent par sorcellerie créer des éclairs, des orages de grêle, des tempêtes".
La manipulation de la météo se retrouve donc dans d'innombrables procès en sorcellerie. La sorcière faiseuse de grêle en particulier est un classique de la démonologie : en Lorraine, dans les années 1590, sur près d'un milliers de procès, 22% mentionnent (entre autres) l'invocation de la grêle. Au XVIe siècle, elle figure dans un acte d'accusation sur 5 à Zurich...
Un orage allemand en 1562 a-t-il relancé la chasse aux sorcières en Europe ?
La cas de l'été 1562 en Allemagne illustre le lien entre caprices de la météo et vagues de persécutions. En aout 1562, l'Europe centrale est traversée par une violente tempête. Après quelques années froides et humides, qui ont amené leurs lots de récoltes endommagées, d'innondations et d'épidémies, la sensibilité de la population à ce type d'événements est déjà exacerbée : la foule gronde et réclame des responsables.
Dans la petite ville de Wiesensteig, entre Stuttgart et Ulm, le seigneur local accepte d'emprisonner quelques femmes. Mais loin de faire cesser les persécutions, ces concessions les attisent : les arrestations sont suivies de torture et, inévitablement, d'aveux et de dénonciations... qui mènent à de nouvelles arrestations, etc. Une mécanique implacable se met en route et bientôt les bûchers fonctionnent à plein régime. Avant la fin de l'année 1562, 63 femmes sont brûlées à Wiesensteig.
Ce massacre, qui a inspiré rapidement plusieurs livres qui seront traduits et réédités, est parfois cité comme le vrai début de la chasse aux sorcières en Europe.
 |
| Représentation contemporaine de l'orage de grêle de 1562 |
"A la Renaissance, un orage de grêle, une gelée tardive ou tout autre événement météorologique qui semble anormal peut conduire des dizaines voire des centaines de personnes au bûcher."
Ces chasses aux sorcières semblent souvent avoir été initiées par un mouvement populaire. Dans certains cas, la foule va jusqu'à élire des délégués qui mènent l'enquête, arrêtent et torturent pour ne remettre les "coupables" aux autorités qu'une fois les aveux obtenus. Au milieu de cette hystérie collective, que font les élites ?.
Les élites : souvent dépassées par un mouvement populaire
Il est intéressant d'observer le rôle de la noblesse et du clergé face à ces désordres. Beaucoup vont laisser-faire et attendre parfois très longtemps l'occasion de reprendre en main la situation : dans la principauté archiépiscopale de Trèves, il faut une décennie (de 1581 à 1591) et 350 bûchers pour que la populace se calme... Quelques uns vont prendre eux-même la tête de la chasse.
Mais d'autres, plus courageux ou plus éclairés, vont tout de même se soulever contre ces pratiques barbares : c'est le cas par exemple de l'archevèque de Reims en 1644, lorsque la foule réclame des responsables pour les gelées tardives qui ont détruit le raisin.
"Face aux calamités, la foule se charge souvent elle-même de trouver les responsables et d'obtenir des aveux. Là où elles ne se sentent pas assurées de leur pouvoir, les élites laissent faire, parfois pendant des années..."
Ce sont finalement ces élites politiques qui auront raison de la chasse aux sorcières. A la fin du XVIe siècle des États forts se construisent en Europe occidentale : la France, l'Espagne, l'Angleterre ne tolèrent plus les élans populaires et décriminalisent la sorcellerie. Les législateurs, sur ce sujet, ont devancé les philosophes...
Mais dans l'Europe centrale et orientale qui reste morcelée et aux mains de dirigeants instables, les persécutions se poursuivent tard dans le XVIIIe siècle.
En conclusion
Il est donc clair que des épisodes météorologiques défavorables ont joué un rôle dans le déclenchement de certaines vagues de persécutions, mais peut-on aller jusqu'à dire que la grande chasse aux sorcières dans son ensemble est causée par la variation du climat que l'Europe connaît à la même période ?
Pour l'historien allemand Wolfgang Behringer, la réponse est oui : selon lui, en provoquant des événements climatiques d'apparence anormale voire surnaturelle, l'entrée dans le petit âge glaciaire a provoqué le retour de la chasse aux sorcières dans la seconde moitié du XVIe siècle et l'a amené à des dimensions inconnues jusqu'à là. D'autres, dont le spécialiste français Emmanuel Le Roy Ladurie, se montrent moins catégoriques.
Retenons simplement ce qui est certain. Les événements météorologiques extrêmes frappent les esprits et détruisent en un instant de longs efforts. Encore plus insidieuses, les évolutions lentes du climat ruinent et tuent sans qu'il soit toujours possible de vraiment discerner les causes de ces calamités. Tout cela appelle des boucs-émissaires. Il en sera probablement de même demain.
Serons-nous capables de mieux nous comporter que nos ancêtres face aux dérèglements du climat ? Evidemment, nous sommes bien mieux informés qu'eux, et déjà à la Renaissance la science était un des antidotes à la barbarie : c'est en partie pour réfuter toute intervention diabolique que la météorologie commence à se développer, sous l'impulsion par exemple de Leonhard Reynmann.
Mais malgré toutes nos connaissances, face aux éléments, n'y-t-il pas un fond d'humanité, ou d'inhumanité, qui reste inchangé - la peur, l'instinct de groupe, le besoin d'explications simples - et qui pourrait l'emporter ?
Les principales sources de cette articles sont :
- La grande chasse aux sorcières en Europe aux débuts des temps modernes de Brian Levack
- L'article de Wolfang Behringer : Climatic Change and Witch-hunting: the Impact of the Little Ice Age on Mentalities
- Le tome 1 de l'Histoire humaine et comparée du climat d'Emmanuel Le Roy Ladurie
Publié le 1er aout 2018 par Thibault Laconde