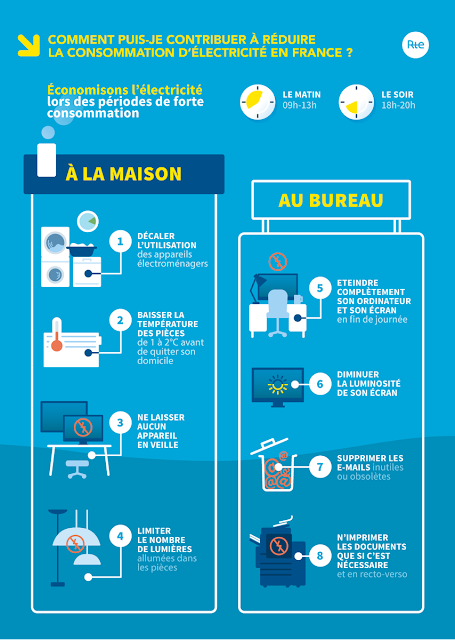Dernier exemple d'une stupéfiante série de records, la France vient de connaitre son mois de mai le plus chaud jamais enregistré. Et si cette vague de chaleur précoce peut paraitre assez bénine, ce n'est certainement pas le cas de celle qui a frappé le sous-continent indien en avril, ou de celle de juin dernier au Etats-Unis et au Canada, ou des trois vagues caniculaires de l'été 2020 en France...
Alors que la liste continue à s'allonger, parfois avec des températures approchant des limites physiologiques humaines, et que la protection contre la chaleur devient enjeu de santé publique, il temps de poser sérieusement la question de la climatisation.
En finir avec un tabou : l'usage de la climatisation augmente en France, et il va continuer à augmenter
Vous vous souvenez probablement de la canicule nord-américaine, à la fin de juin 2021, et de l'image choc des "cooling centers", les refuges climatisés mis en place, par exemple, à Seattle et Vancouver pour acceuillir les habitants exténués par la chaleur. En France, nous n'avons pas encore vu ces images mais, depuis 2005, les établissements acceuillant des personnes agées doivent disposer d'une "zone refuge" où les pensionnaires peuvent se rafraichir. Et pour les autres personnes vulnérables, âgées, malades ou handicapées ? On leur recommandera, sans ironie, de se transporter dans un lieu public climatisé.
Si vous êtes pris par surprise et que vous devez gérer dans l'urgence une vague de chaleur inattendue, toutes ces idées sont raisonnables. Mais enfermer les personnes à risque dans une unique pièce climatisée ou leur demander d'aller passer leurs journées dans une galerie commerciale est un bien triste substitut à une vraie prévention... ne serait-ce que parce que l'impact sanitaire est autant causé par les chaleurs nocturnes que diurnes. Face à l'aggravation chronique des canicules, la seule solution durable pour les personnes vulnérables est de disposer d'un logement rafraîchi.
Ces chiffres sont discutables : en 2018, l'Agence Internationale de l'Energie évaluait encore le taux d'équipement des foyers français à 5%. Mais il est clair que la climatisation se diffuse rapidement en France, comme d'ailleurs dans tout le sud de l'Europe. Toujours selon l'AIE, 12 millions de climatiseurs sont vendus chaque années dans l'UE, les 3/4 à usage résidentiel. Le nombre de climatiseurs en Europe aurait ainsi doublé entre 1990 et 2016 et devrait encore tripler avant 2050 pour atteindre 275 millions.
Les limites de la réglementation thermique
Même si la France a encore le climatiseur honteux, l'explosion de l'usage de la climatisation est déjà en cours. Et ce n'est pas la réglementation thermique des bâtiments qui sera en mesure d'infléchir cette tendance.
Jusqu'à récemment, elle écartait à demi-mot la climatisation pour les nouveaux logements. En effet, les consommations d'énergie maximales autorisées par mètre carré étaient a priori incompatibles avec son usage en dehors du pourtour méditerranéen. Cependant la climatisation n'était pas explicitement interdite et, dans la pratique, ces règles ne faisaient souvent que repousser son installation de quelques mois : beaucoup de logements neufs se retrouvaient très vite équipés après leur livraison.
La toute nouvelle réglementation environnementale 2020 reconnait cette réalité et change d'approche. Elle introduit le concept de "climatisation fictive" dans le calcul de la performance énergétique des futurs bâtiments : même si le projet ne la prévoit pas, une climatisation est comptabilisée dans la consommation d'énergie lorsque la température intérieure dépasse certains seuils.
Le message de la RE2020 : "Vous avez un projet de construction neuve non climatisée ? Bravo citoyen ! Mais on a vu vos plans et on sait que vous allez changer d'avis à la première vague de chaleur." La nouvelle réglementation thermique prend acte que l'équipement de certains logements ne pourra pas être évité.
Comment anticiper les effets de l'équipement en climatisation ?
C'est déjà un progrès puisque cette reglementation sanctionne indirectement les concepteurs de nouveaux projets qui n'assurent pas un confort thermique minimal en été. Malheureusement, elle ne porte que sur les logements neufs, c'est-à-dire sur une toute petite partie du problème. Pour les logements existants, les rayons des supermarchés sont déjà encombrés de climatiseurs mobiles attendant la prochaine vague de chaleur, et la ruée...
Est-ce que cela signifie qu'il est impossible d'endiguer l'usage de la climatisation ? Je pense que oui : avec la multiplication des vagues de chaleur estivales, il est illusoire d'espérer que les français vont arrêter d'acheter des climatiseurs et, une fois qu'ils seront équipés, il est illusoire de penser qu'ils ne les utiliseront pas.
La bonne question est plutôt : est-ce que les conséquences de cet usage croissant sont gérables, et comment peut-on en limiter les effets négatifs ? Une étude publiée récemment par Callendar et Colombus apporte un début de réponse.
Pour cette étude, nous avons simulé la consommation électrique d'un quartier du sud de la France pendant un été des prochaines décennies. Le quartier est composé de 100 logements climatisés dont les caractéristiques (surface, nombre de pièces, performance thermiques, etc.) sont basées sur une ville moyenne de la région Sud. Les besoins journaliers en électricité sont calculés à partir de ces caractéristiques et de conditions météos issues d'une projection du climat 2021-2050 réalisée par Météo France.
Pour évaluer l'impact technique, économique et social de l'équipement en climatiseurs, nous avons réalisé plusieurs dizaines de simulations en faisant varier la vitesse de rénovation des logements, la façon dont la climatisation est utilisée, la performance des appareils, etc.
Climatiser sans drame : quelques pistes
Première conclusion : dans tous les cas, l'équipement en climatisation entraine une hausse de la consommation d'électricité et de la thermosensibilité. Climatiser a donc toujours un coût pour l'utilisateur et pour le système électrique, pas de surprise ici... Cependant il apparait très vite que le même niveau d'équipement en climatisation peut avoir des impacts très différents selon les hypothèses choisies.
 |
| Puissance nécessaire à la climatisation du quartier pour différents scénarios (rénovation thermique, rendement des climatiseurs, etc.), en fonction de la température moyenne de la journée |
Améliorer l'efficacité des climatiseurs offre probablement un meilleurs rapport coût/efficacité surtout si cela peut être fait pendant que le taux d'équipement est encore limité. Et même sans progrès technique, il existe une réelle marge de progression. En Europe, la performance moyenne des climatiseurs reste faible par rapport à l'offre disponible. Equiper notre quartier avec les climatiseurs les plus performants disponibles sur le marché plutôt qu'avec le climatiseur moyen actuel permettrait par exemple de diviser par deux la consommation d'énergie nécessaire !
Enfin, les simulations montrent que le comportement de l'utilisateur est crucial : bien régler la température de commande, aérer avant de climatiser, fermer les volets en journée... Des actions simples et peu contraignantes permettent de réduire significativement la consommation d'électricité.
Ce dernier axe est particulièrement important, tout simplement parce que lorsque vous brancherez votre premier climatiseur, il n'y a aucune raison que vous sachiez l'utiliser efficacement : on vous a appris à bien utiliser l'éclairage ou le chauffage mais jamais la climatisation... Pour préparer les étés caniculaires des prochaines décennies, il est donc indispensable de développer l’éducation à l’utilisation efficace de la climatisation, et plus généralement la sensibilisation aux effets de la chaleurs et aux moyens de s’en protéger.
Publié le 31 mai 2022 par Thibault Laconde